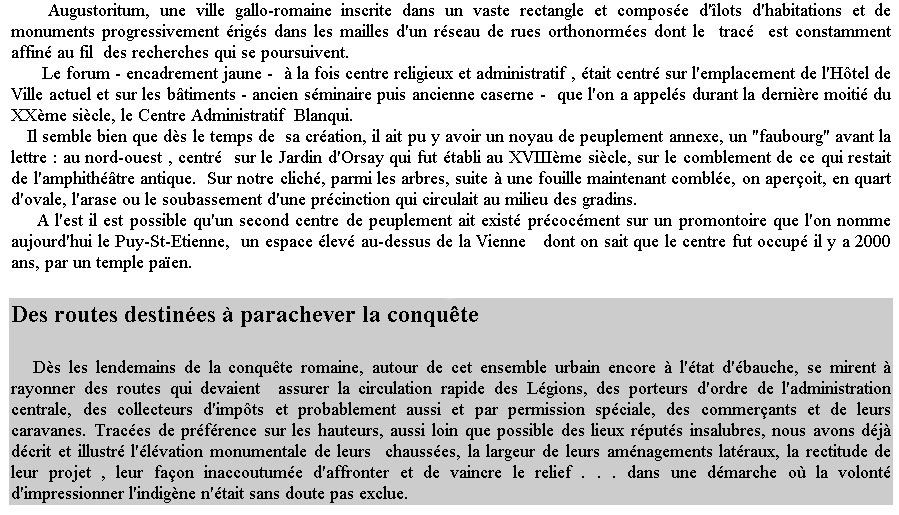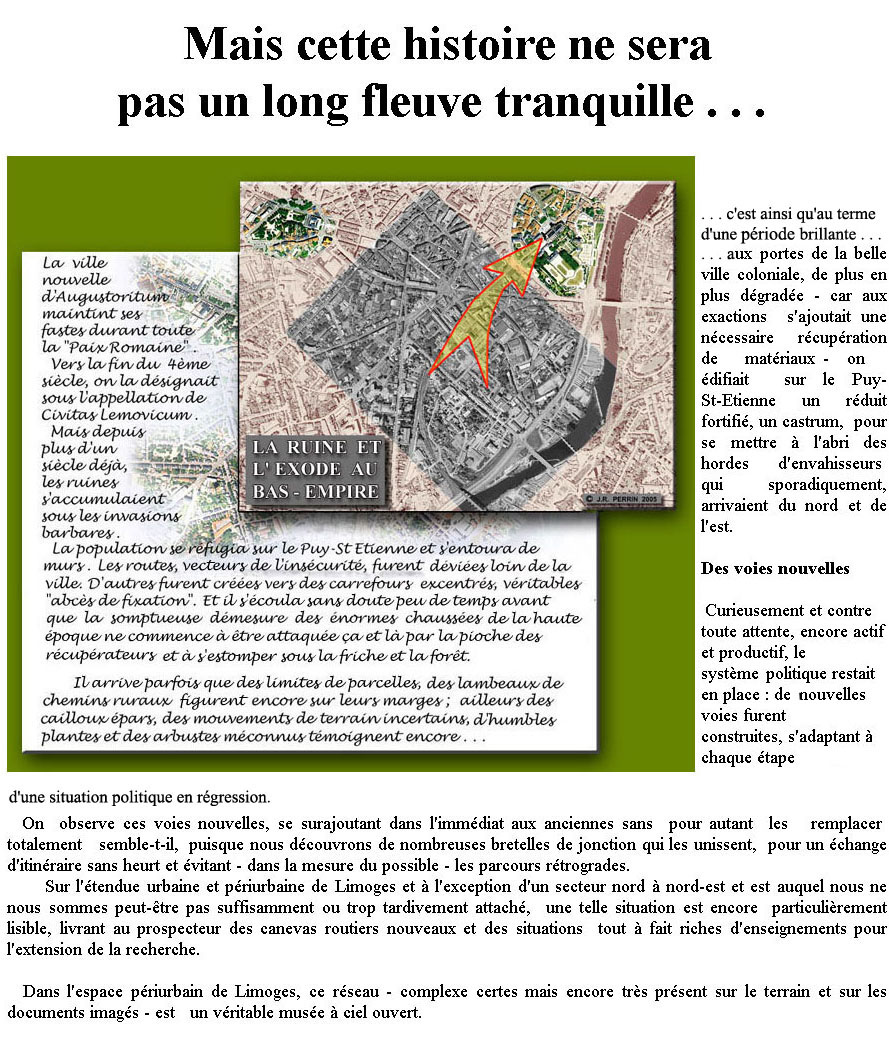Disons tout de suite que les deux portes
ainsi représentées de la ville antique, ne font plus
problème pour nous depuis la longue enquête
que nous avons mené sur le sujet :
- à l'ouest, point de départ des voies de
Saintes (Mediolanum, en son temps ville-phare de la province d'Aquitaine) et de
Périgueux/Vesunna (la direction de Bordeaux : Burdigala), ne peut être que le carrefour
de la Croix-Mandonnaud que l'on ne peut séparer selon le temps et l'époque , du Carrefour Beaupeyrat.
- A l'est, le complexe Place Maison-Dieu, Porte-Tourny (Place Jourdan), Casseaux, est tout aussi explicite pour les
voies de Lyon (Lugdunum) et la voie de Bourges (Avaricum). Bourges qui fut elle aussi
en son temps, capitale d'Aquitaine.
Ainsi Cassinomago (Cassinomagus) à l'ouest (point rouge),
figure à 17 lieues gauloises d'Augustoritum, distance
parfaitement exacte. C'est l'étape importante et
monumentale de Chassenon.
Pour
les
spécialistes, les noms latins de nos villes actuelles sont en majorité connus
mais quelques-uns font encore problème. Ainsi, supputations mises à part,
la localisation de Sermanicomago au-delà de Chassenon est inconnu et si plus
loin, Aunedonnacum est l'ancien nom d'Aulnay, on peut se demander ce
que le rédacteur et/ou les copistes de la Table ont voulu
représenter en inscrivant ici une localité
située très au nord de la ligne directe
Limoges-Saintes :
on peut toujours penser à un itinéraire de liaison ou de
jonction mais à ce jour rien n'est évident.
Toujours à l'ouest mais sur la seconde voie voie,
Vesunna est Périgueux et Fines
(Thiviers peut-être), l'étape-frontière entre les
Lémovices et les Pétrocores. Au bout du chemin Burdigalo, Burdigala est Bordeaux. Mais Périgueux (Vesunna)
précisément, situé à plus de 100 km de
Limoges n'en affiche guère plus de 60 pour le rédacteur
de la Table.
A l'est
de Limoges, Acitodunum serait
Ahun mais Pretorio reste
mystérieux. A cet égard, il est probable que la mention
XIIII se rapporte à la distance entre la porte de la ville
antique et la première inflexion de la voie vers Avaricum
(sous la mention Bituriges). On sait seulement que le nom de
Pretorio représentait à
cette époque, un site
d'étape voire de séjour certainement somptueux, pour
d'importants personnages en mission : quelque chose comme un
hôtel pour
super-préfets IGAME ( "Inspecteurs
Généraux de l'Administration en Mission Extraordinaire")
ou carrément un gouverneur de province, un "procurator".
L'érudition locale
bataille toujours sur la localisation de ce qui fut sans doute un bel
édifice plutôt qu'une petite ville. Et pour cette
résidence, on a pu
essayer tout récemment de valider le site de
Sauviat-sur-Vige : sacrée décentralisation !
Fines représente la
frontière entre les Lémovices et les Arvernes dont la
capitale, Augusto-Nemeto, s'appelle aujourd'hui Clermont-Ferrand. Après cela, la
voie poursuivait jusqu'à Lyon (Lugdunum) capitale des
trois Gaules.
Mais, déjà nous avons perdu pied car le chiffrage
des distances, à nouveau, ne correspond à rien de simplement plausible.
Sur l'étape de
Limoges à St-Priest-Taurion, les itinéraires admis et
constamment rappelés par l'histoire locale depuis un
demi-siècle, sont divers, inutilement compliqués et nous n'ont
laissé au sol aucune trace.
Mais par contre et sur
une route venue par d'autres chemins, le St Priest d'antan est bien sur
la voie ainsi qu'en témoigne un gué proche de la vieille
église.
Et
de là jusqu'à Sauviat, le tracé
proposé
par COURAUD est assez bien cadré. Mais il a récemment
été pollué sans besoin par des propositions qui
émanent d'une recherche au sol (?) qui ne s'est pas encore approprié les
grands traits de la doctrine routière antique.
La
seconde voie,
toujours à l'est d'Augustoritum, est nécessairement orientée
au nord puisqu'elle va à Avaricum (Bourges).
Sur la Table et après une brusque inflexion , nous lisons
un
embranchement
vers Poitiers (Lemonum)
et celui-ci fait encore problème bien que l'on propose
encore et toujours des cheminements "bouche-trou" sans queue ni
tête et inutilement tourmentés.
L'archéologie a horreur du vide !
Une réputation mitigée
On comprendra dès
lors plus aisément pourquoi la
crédibilité de la vénérable Table de
Peutinger est généralement
médiocre au sein
des cénacles savants : le grand Camille JULLIAN
la considérait comme une totale ineptie. Plus
près de nous et pour Raymond COURAUD, qui tentait en 1960
de réhabiliter les itinéraires anciens à
partir d'autres sources, elle
avait
" la valeur d'un agréable et
inoffensif jeu pour les jours de pluie".
Ce
document figuré se montre paradoxalement
à la fois trop précis et trop ambigu,
pour
coller aux propositions "éclectiquement" savantes bien
qu'intensément évolutives, des
archéologues - au demeurant
peu nombreux - qui
poursuivent aujourd'hui sur cet étroit créneau , des
publications confidentielles.
Aussi, nous voyons bien que, pour
préserver un gisement où tout un chacun peut à tout moment puiser matière à une
nouvelle analyse et à de nouvelles thèses, on en pratique la lecture avec prudence et on observe
à son égard, une certaine suspension de jugement.
Nous savons aujourd'hui et nous l'avons dit, que le
relevé enfin exact et exhaustif de ces anciennes
voies antiques qui nous échappent encore, sera le
fait de prospecteurs laborieux et décomplexés qui se seront donné un jour, les
moyens de devenir - guidés par des images aériennes - des
analystes de terrain pointilleux.
Et qui pourront
voir un jour, leur patient travail éclairé par
l'apport érudit et le jugement de
l'archiviste savant : un sujet mineur entrera ainsi véritablement
dans l'Histoire.
Il
se pourrait
qu'à ce compte la table de Peutinger en soit un peu
réhabilitée : comme une très vieille Chanson de
Geste.
|