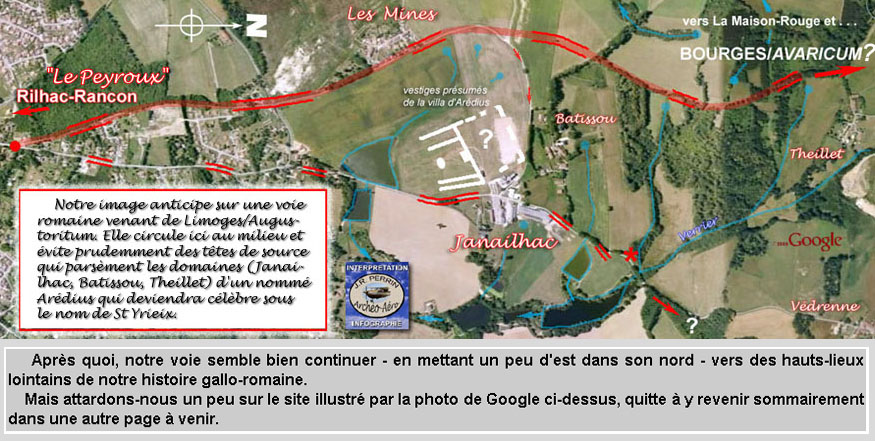|
Jean Régis PERRIN
La voie antique d'Avaricum (Bourges) et la villa d'Arédius au milieu de champs miniers gaulois dédiés à Bélénos (Beaune). Puis le terroir gaulois du Breuil de Morterolles :
voie traditionnelle et voie romaine, fossoyages anarchiques (?) et enclos d'habitat, thermes rustiques (?) et sanctuaire routier. Et une voie traversière de très ancienne origine dont les avatars sont devenus pérennes quand elle fut ravaudée par les romains. |
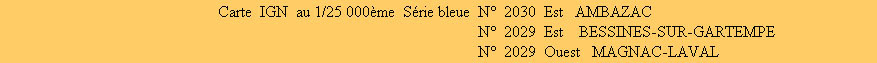
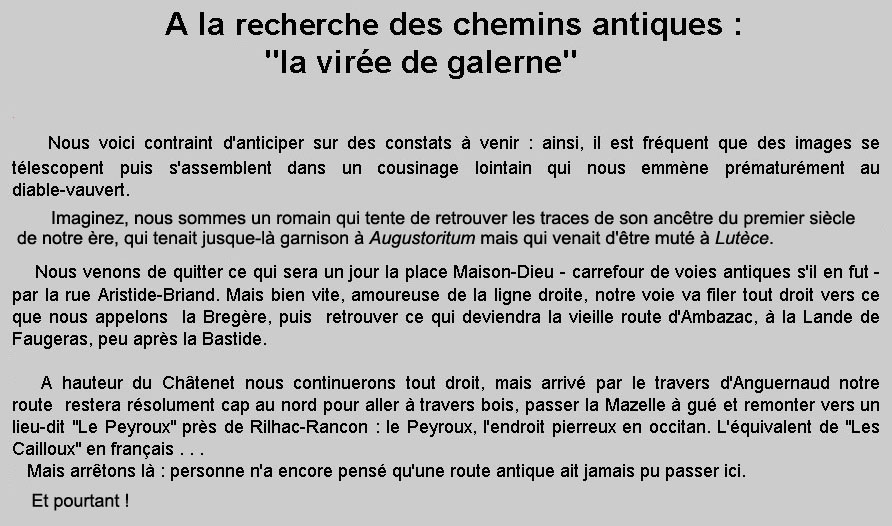
Le testament de Saint-Yrieix : "Génolac" et Janailhac
|
Un jour, j'étais en vol pour tenter de prolonger vers le nord
cette voie qui venant de Limoges, m'était familière jusqu'aux
mines de Beaune (en fait, commune de Rilhac-Rancon).
|
 |
Mais quelques menus détails me laissaient à penser que cette voie pouvait comporter un embranchement vers le nord-est au dessus de Rilhac-Rancon . . .
Finalement, rebuté par le manque apparent d'indices, j'avais provisoirement abandonné ce parcours prometteur mais difficile, sur la limite nord de la commune de Rilhac.
Mais de temps à autre et par acquis de conscience, j'effectuais un léger détour pour prendre
"mécaniquement" quelques photos verticales sur le
site.
A deux reprises, des images fugaces sur un labour en cours de ressuyage, me semblèrent montrer quelque chose d'insolite. |
|
C'était
la cour immense d'un possible domaine agricole
bordé de toutes parts par de grandes terres portant encore des
signes que l'on pouvait avec quelque raison, attribuer à des recherches minières très anciennes.
Or parmi l'étendue des terres agricoles, cette parcelle était la seule à ne porter aucun stigmate de recherches minières . Et il m'était en effet revenu, comme un vieux souvenir de lecture impossible à resituer, les propos d'un ingénieur qui dirigeait au début du XXème siècle, des travaux miniers sur cette zone. Il y avait retrouvé des outils d'excavation qu'il faisait remonter aux temps de l'indépendance gauloise ou de la précoce période gallo-romaine. Analysant certaines traces de travaux anciens que ces terres avaient supportés, ce spécialiste arrivait à la conclusion que des carriers gaulois avaient dégagé ici des têtes de filon de quartz et avaient allumé là-dessus des feux d'enfer. Puis ils les auraient refroidis brusquement sous des trombes d'eau et recherché ensuite l'or natif dans les fragments de la roche éclatée. On comprend que ces images me soient restées à défaut du nom de l'auteur. Et voilà que mes observations aériennes ne contredisaient pas ce point de vue : sous une légère humidité, la terre nue des grandes parcelles qui entourent cette possible cour de villa, prend la couleur rubéfiée de la brique pendant que de longs fossés exposent la couleur noire du charbon de bois finement broyé par des siècles de culture. J'observais également des traces de bâti. Et quelques voies de circulation se révèlaient au franchissement des ruisseaux par un décaissement en amont des rives et les empreintes de leurs fossés latéraux (vignette ci-dessous). |
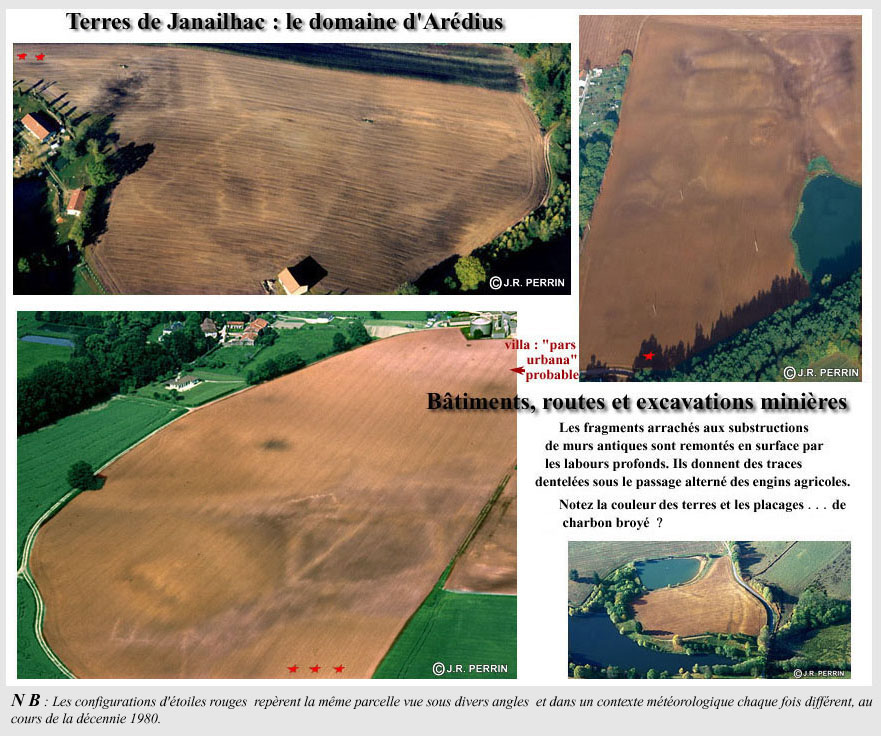
|
Sur les nombreux clichés que j'ai pu faire de façon systématique,
en passage vertical sur le site, la parcelle qui apparaissait vierge
de tout indice archéologique me
révéla un jour des traces - très
faibles certes - mais véritablement structurées et
interprétables. Cette parcelle dépend de la ferme de Janailhac toute proche.
Renseignement pris aux meilleures sources (Fernand GAUDY), le site était
connu
de vieille date par des trouvailles de fragments de tuiles romaines. On me dit que j'étais
très probablement arrivé sans le savoir, au milieu de propriétés ayant appartenu à la fin des temps antiques, à un nommé
Arédius qui deviendra célèbre sous le nom de
Saint-Yrieix.
Par testament le saint homme fit don d'un de ses domaines au chapitre de la toute récente Abbaye Saint-Martial qui s'édifiait au nord-est des ruines de l'antique Augustoritum. On désignait d'ailleurs et depuis longtemps déjà, ce qui restait de la ville, dont les habitants avaient migré sur le Puy-St-Etienne, sous le nom de"Civitas lemovicum". Pour autant que l'on puisse le déchiffrer sur le vénérable testament daté de 572 , le nom de l'une de ces propriétés s'écrivait "Génolac" - ou quelque chose d'approchant selon Fernand GAUDY. A comparer au Janailhac actuel.
Mes images restituées sur fond d'ortho-photo-plan de l'IGN
montrent l'angle très net d'une cour de villa ouverte
au
sud-sud-est et bordée latéralement par de grands
bâtiments. L'obliquité apparente de l'aile droite a
peut-être été contrainte par une voie de
circulation secondaire que nous venons d'évoquer au paragraphe
précédent.
Une construction en U est adossée au mur nord : elle serait selon les fouilles de certaines grandes villas antiques connues en France, la demeure du vilicus, le régisseur et chef de culture. Du même coup, la partie dévolue à la résidence du propriétaire pourrait se situer au-delà de ce mur de séparation. Je n'y ai jamais rien vu de précis, mais un abondant mobilier antique très fractionné et érodé jonche le sol sur cette partie haute du site à l'aspect très minéral (surimpression rouge sur le report IGN et zone plus claire sur notre photo ci-dessus) et dont le sol semble avoir été profondément remanié dans les dernières décennies. Quant à la voie principale qui m'avait amené jusqu'ici, (voir les photos ci-dessus), ce n'est plus qu'un petit chemin qui vient de Rilhac-Rancon et qui, après avoir coupé la route de Beaune-les-Mines, pénètre à peine carrossable, dans la vieille zone minière où il finit en chemin agricole, longeant à l'ouest les terres de Janailhac. J'espérais toujours pouvoir en prolonger l'axe principal et au moins confirmer une prochaine étape à Maison-Rouge, sur notre ancienne Nationale 20. Le hasard allait me donner l'occasion de retrouver un prolongement possible bien que lointain, à cet itinéraire antique délaissé. |
La villa d'Arédius
 |
Nous n'avons
pas voulu partir plus loin vers le nord sans vous offrir ce qui reste
de "la villa d'Arédius". Sur notre cliché, les traces
déjà fugaces il y a 28 ans ne se sont pas
densifiées, bien au contraire.
Décidémment, un siècle n'est rien en archéologie !Elles permettent cependant et au moins, de montrer que nous n'avons pas rêvé et que les couvertures verticales systématiquement exécutées sur des sites sensibles, finissent toujours par payer : ce pourrait être une bonne résolution pour la nouvelle génération d'archéologues du prochain siècle. Ce pourrait être aussi l'occasion de prendre conscience des trésors qui dorment dans les collections de l'IGN depuis 60 ans et plus et nous ne manquerons pas de vous donner un aperçu des instruments qui permettent d'analyser ces documents - des pièces de musée et de brocante dont l'immense majorité est issue des enseignements et des expériences de la guerre de 14. |
| Et puis une autre image encore parmi d'autres mais qui n'apporte que peu de chose à ce grand vide historique. Nous proposerons cependant, ( dans une prochaine page : "l'affaire de la voie de Lyon, première partie" ) des tracés de voies antiques non loin de ce site. |
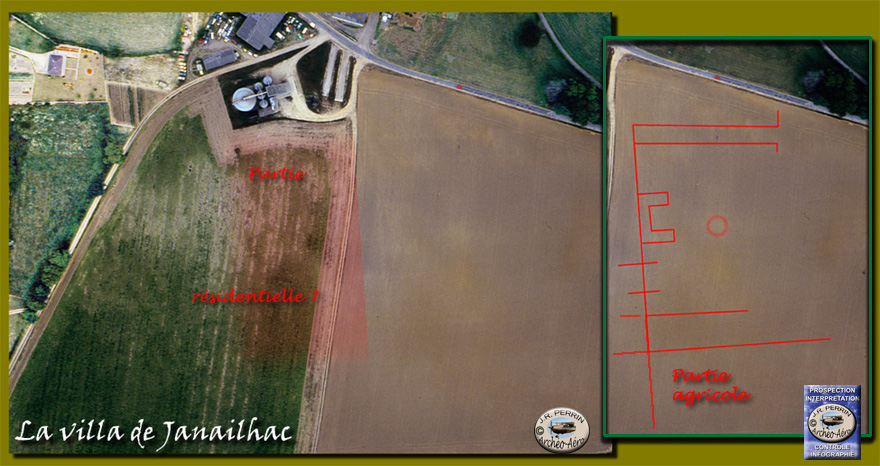
La Croix du Breuil
|
Or il
arriva qu'un jour le chantier de l'autoroute A 20 dite
"L'Occitane", nouvelle route de Paris à Toulouse, se rapprochait de notre
département. L'inventaire archéologique des terres qui
allaient être occupées par le tracé routier,
était en cours.
Je connaissais en contre-bas du site de la Croix-du-Breuil, entre
Gartempe et Semme, entre Bessines et Morterolles, sur le
dos d'une colline criblée de fossoyages et d'enclos, une route gauloise bien rectiligne sur
plusieurs centaines de mètres
et bordée
par quelques traces de fossés. On pouvait même remarquer
un embranchement partant vers l'ouest et encore marqué à
deux
millénaires d'intervalle, par deux rangs parallèles de
quelques chênes. Cette voie très primitive allait
être emportée
par la sortie 23-1 dite "de Morterolles", de la nouvelle
autoroute.
 z z |
|
N B
: Rappelons à la suite du constat énoncé à la page précédente, que la piste gauloise
vieille de 2000 ans et plus,
a ceci de
particulier qu'elle est indécelable aussi bien au sol
qu'en vision aérienne . Parfois cependant et sur de courtes
distances, elle se matérialise dans la
proximité des sites habités
et des sanctuaires par deux fossés parallèles - étroits et
profonds selon notre constat sur la ferme de La Chatrusse - et devient donc visible de ce fait .
Elle peut revêtir également sur quelques centaines de
mètres une apparence "rubanée" aux strictes
limites latérales, comme une trace issue d'un long
piétinement canalisé (Chassenon, Villejoubert . . .)
|
|
Mais dans le même temps je fis la découverte supplémentaire d'une
trace verte qui suivait en parallèle la limite Est d'une parcelle.
Cette limite de parcelle consistait en un fossé envahi par un buisson. Il me vint assez vite à l'esprit que cette trace verte pouvait être ce qui restait d'une chaussée romaine pillée puis remblayée par le tout venant et les gravats. D'autant que le fossé ne se limitait pas à notre parcelle. Il courait sur près d'1 kilomètre entre Le Breuil et Morterolles à l'est de la trace verte, conservé ici depuis 2000 ans. Il appartenait donc bien à la voie antique. L'autre était invisible; comme l'espace de la chaussée, il avait été récupéré de très longue date en terre agricole.
D'orientation
nord-sud cette voie avait toute chance d'être le prolongement de
celle que j'avais abandonnée dans les terres de Janailhac et qui
venait ici se surimposer à des indices d'occupation du sol
d'origine gauloise.
|
|
Cela dit et dans le cas qui nous occupe, je rappellerai la difficulté de décrire avec certitude à partir de vues un tant soit peu lointaines, l'origine précise de ces bandes qui alternent leur apparence sur les cultures et sur les prairies, tantôt humides tantôt arides.
Elles trahissent sans aucun doute des chaussées
routières mais on
ne sait pas exactement comment se comportent, dans l'évolution
d'un
épisode de sécheresse prolongé, un fossé
comblé (selon sa taille, la
nature du remplissage, le milieu encaissant . . .) ou la fouille
d'ancrage d'une ancienne chaussée, pillée puis
rebouchée de gravats et
de rebuts. Nos commentaires à ce sujet ne sont donc que des
hypothèses plausibles. Concluons donc ici à la
présence certaine d'une voie antique mais ne cherchons pas
à dire si :
- la trace verte appartient à l'ancienne chaussée : hypothèse plausible au vu de la première photo (de découverte du site), - ou représente son bas-côté ouest, ce que semble indiquer les photos suivantes. Mais l' apparence des traces a probablement alterné plusieurs fois dans l'intervalle des clichés. Sur ce sujet, la
littérature régionale nous propose de nombreux
croquis de coupes de chaussées et de tranchées
routières.
Les coupes et plus souvent les profils en travers, concernent des
voies ruinées et détruites ou fortement
délabrées par un usage deux fois millénaire.
De surcroît, les voies n'étant pas restituées dans une continuité suffisamment serrée, on n'est jamais sûr de ne pas s'être égaré sur des diverticules. Et je ne citerai qu'un seul exemple que je dédie aux spécialistes : le très long diverticule de Saint-Auvent n'est pas la voie d'Agrippa . . . Les tranchées routières quant à elles apparaissent souvent fortement colmatées parfois affouillées par le ruissellement et peu susceptibles de nous renseigner sur la largeur et l'architecture des voies. C'est assez dire que les fouilleurs n'ont jamais été clairs sur l'énormité des chaussées précoces et pas davantage |
|
sur l'existence de ces banquettes latérales où, selon nous,
circulaient les animaux de bât, la
cavalerie, les piétons. . . et dont la présence
signerait leur origine de "voies de la conquête".
Pourtant le site existe qui permettrait cette investigation et ferait la lumière sur ce problème: c'est la Forêt des Vaseix mais de propos délibéré, ce choix n'a pas été fait . Nous en sommes donc réduits à nos seules images.
On peut
imaginer que la préparation de ces pistes cavalières latérales
commençait par un décaissement large mais peu profond. Cette tranchée
pouvait ensuite être remblayé de sable ou d'arène légère, matériaux de confort et propres à éviter des blessures aux pieds de bêtes lourdement chargées.
|
 |
|
Les
romains ne pratiquaient pas le ferrage des chevaux : pour
les animaux de trait et pour eux seulement, qui circulaient
nécessairement sur les chaussées, on avait inventé les hipposandales.
|
Extension du problème
|
On
ne trouva pas de mobilier archéologique sur la parcelle récemment labourée qui affichait nos voies protohistoriques et
antique au
nord de la Croix-du-Breuil.
Il faut dire qu'en l'état, l'icône aérienne au demeurant assez vague pour le néophyte, ne correspondait pas davantage à quelque chose de tangible dans la doxa archéologique limousine aussi savante qu'approximative au chapitre des voies antiques. Et le site ne fut pas fouillé avant le décaissement de la sortie d'autoroute.
Par simple curiosité, je poursuivis la
surveillance
aérienne pendant les travaux. En effet, des signes concordants
me donnaient à penser qu'il y avait eu là dans un
passé très ancien, un vaste domaine gaulois ou gallo-romain.
|
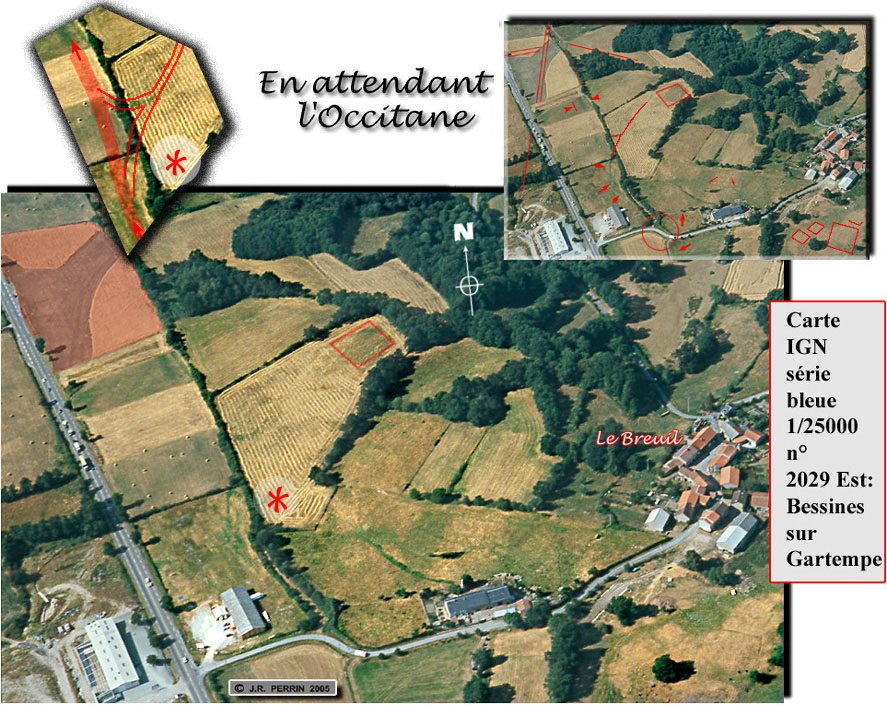
|
Sur le panneau photographique ci-dessus une surimpression
rouge rappelle la parcelle qui portait les traces d'origine
: deux ans se sont
écoulés, l'emprise routière de la sortie-échangeur est
déjà délimitée.
Sur les parcelles situées au sud des travaux, on retrouve la large trace verte qui nous avait intrigué lors de la découverte du site. Elle figure en long et entre flèches jaunes sur le cliché d'origine, en tête de ce paragraphe et en largeur, entre pointes rougessur la vignette explicative ci-dessus. Elle est toujours parallèle au fossé, envahi par une haie arbistive, déjà signalé qui court de la Croix-du-Breuil à Morterolles.
Ces énormes
chaussées dont nous reparlerons souvent, furent bâties immédiatement
après la conquête : des voies destinées à parachever la main-mise sur le pays et . . . à
impressionner le gaulois. Elles demandaient certainement un gros
entretien et nous osons dire que le roulage devait y être
très incommode. Elles furent utlisées
durant un, deux, trois siècles au plus. Elles furent finalement pillées de leurs
éléments les plus intéressants au profit
d'intérêts privés peut-être ou bien au profit
d'autres
voies aux horizons plus limités, moins grandioses mais plus
adaptées aux temps troublés du Bas-Empire.
Mais depuis ce temps-là, nous
le rappellerons souvent, le remblayage fractionné de ces longues
tranchées constitue un réservoir d'humidité
très
performant qui nourrit de longues bandes d'herbe verte lors des courtes
périodes de sécheresse. Tantôt, ayant épuisé ses réserves
d'eau avant le terme d'une longue période de canicule, il devient une
longue trace
brûlée. Avec ces nuances, les fossés latéraux
également comblés et les bas-côtés, participent également à l'image.
|
| Notons qu'en se rapprochant du village du Breuil, la voie antique a subi une contrainte de tracé qui
se devine encore dans la parcelle qui porte un
bâtiment commercial, en bordure de l'ancienne RN 20. Cette
déviation très localisée, pourrait être due
à la présence du petit sanctuaire de sommet qui figure sur mes images. Sur mes photos, de part et d'autre de la voie romaine, des indices
d'occupation du sol apparaissent : ils sont répertoriés
sur les différents clichés présentés et
explicités sur le panneau IGN qui clôt ce chapitre.
|
Une image classique de la prospection des voies antiques.
|
Quant au
tracé "en
baïonnette" de la route qui dessert le village du Breuil, nous
avons là un
exemple classique d'un petit cheminement vernaculaire
(créé dans un
passé lointain mais que l'on peut situer entre la
désuétude de la voie romaine et sa destruction ) et
qui a
dû affronter alors le croisement avec l'énorme masse
caillouteuse de la chaussée antique. On peut imaginer qu'une
montée biaise sur le monument fut sans
doute aménagée. Puis il s'ensuivit un
court cheminement sur le faîte du massif, jusqu'à trouver
une
opportunité de descente : le pli était pris et le cours
de la petite route scellé pour de nombreux siècles.
Le cadastre napoléonien recèle de nombreux exemples
de ces parcours chaotiques de petits chemins communaux : certains ont
été rectifiés de vieille date mais beaucoup
subsistent encore.
Et quand bien même tout a disparu, il
arrive qu'on les retrouve fossilisés sur de vieilles photos
aériennes où ils contribuent dans certains cas d'espèce, à
révèler et à valider l'origine
antique de noyaux de peuplement devenus de petites villes : ce pourrait
être - tiré d'un document vieux de plus d'un
demi-siècle que nous produirons en temps opportun - le cas exemplaire de la ville d' Isle, à partir de
"La Cornue", la bien nommée.
|
 |
Mais nous n'avions pas épuisé les ressources du site.
 |
Une année
était passée et le chantier autoroutier avait
avancé.
En vol, un jour, je remarquais que l'état des terrassements pouvait avoir
mis à découvert quelques détails de mon puzzle archéologique.
Et le dimanche suivant, sans attendre davantage, je pris l'initiative de visiter le chantier sans autorisation mais sans grand risque d'être dérangé. A
pied sur le site, je fus
déçu mais pas véritablement surpris de ne trouver
que des traces très vagues des fossés que j'avais
repérés en vol quelque temps auparavant : quelques pierres résiduelles
au niveau de l'ancienne chaussée antique, une terre à peine plus brune
. . .
|
| Mais
mon
attention fut attirée, au plus près de l'ancienne
Nationale, par la reprise en pente douce d'un long talus. Le rajout de
terrassement est bien visible sur mes photos. Et à un mètre environ
sous le niveau de
la pelouse, 4 ajutages de canalisations en céramique rouge
avaient été mis au jour par les engins.
Autour
de 3 extrémités de poteries brisées et à
l'emplacement de celle manquante, on pouvait constater que la terre
avait pris une
coloration bleu-noir-foncé qui
témoignait d'une
étanchéité très imparfaite du réseau
mais surtout d'un liquide transporté très pollué.
Paysan d'expérience, je sus immédiatement qu'il ne pouvait s'agir que d'un liquide analogue aux effluents domestiques de lavage et de lessivage ou de résidus de cuisine qui s'écoulaient jadis dans les cours de ferme, en provenance de la pierre d'évier que l'on nommait dans ma Basse-Marche natale "la mareye". On pourra faire la même remarque aujourd'hui si l'on a l'opportunité d'observer des fuites sur des canalisations d'eaux usées en provenance de cuisines ou de salles de bains.
On
remarquera à l'examen attentif des documents,
que l'ajutage des canalisations était visible sur mon
dernier cliché aérien mais hors de portée
évidemment de toute espèce d'interprétation
sensée avant la
visite au sol ( flèches rouges dans un cadre jaune).
Ceci admis, on observera également que le linéament à l'extrémité courbe figurant plus haut, sur le cliché d'origine, est directement lié à la canalisation située le plus au nord qui venait ainsi se déverser dans le fossé Est du chemin gaulois. D'autres linéaments se discernent, des traces au sol correspondant aux trajets des autres canalisations, orientés perpendiculairement à la voie romaine celles-là. Ces traces d'aqueduc semblent toutes provenir, en passant sous la voie antique, de ce petit bois rectangulaire situé de l'autre côté : nous ne savons pas ce qu'il nous cache mais une explication ne doit pas être simple. Parmi d'autres débris, j'eus la chance de pouvoir récupérer intact l'élément de conduite manquant qui avait roulé au bas de la pente. Le contexte archéologique contredit l'apparence d'une facture moderne qui serait celle d'un procédé d'extrusion mais aucune publication archéologique connue ne donne à penser qu'un tel procédé ait pu être maîtrisé à cette époque. L'élément récupéré mesure 323 mm de longueur ( tiens ! un pied romain ) pour un diamètre externe de 70 mm et une épaisseur de parois de 10 mm. Les fragments des autres éléments brisés sont de nature parfaitement identique. On a
retrouvé
dans les fouilles de Chassenon, des tubuli
de taille variable mais de fabrication tout à fait conforme
comme on peut le voir dans les caves des Thermes (voir la vignette sur le panneau photographique ci-dessus). Notre
élément de canalisation apporté là à
titre de comparaison, est comme on le voit de même facture mais sensiblement plus
gros que celui qui figure en exposition (oui, on avait
égaré la clé de la vitrine !).
Restait à comprendre comment ces éléments de
conduites pouvaient être raccordés. Les embouchures ne
présentant aucun dispositif d'emboitement, on imagine qu'elles
pouvaient être lutées à franc-bord avec quelque
pâte dont nous n'avons pas trouvé trace . . . d'où
les fuites !
Une esplanade
Une ultime remarque, nous avons observé que la zone
repérée par une étoile rouge (et / ou un aplat rouge sur les photos qui entourent ce texte), donne au sol,
la nette impression d'avoir été travaillée en esplanade,
ce qui irait dans le sens de l'existence ici, d'une ferme
gauloise ou d'une villa gallo-romaine aux époques
protohistorique et antique.
Mais peut-être pas d'une villa romaine qui elle, aurait sans doute laissé des traces plus consistantes et aurait déjà été remarquée. Encore qu'on puisse avoir de belles surprises dans les déserts archéologiques ( voir la page suivante). Et à ce propos, avez-vous remarqué que la petite route qui va (qui allait !) du Breuil à Morterolles marque une inflexion en "chapeau de gendarme" à ce niveau (pointe de flèche rouge sur la photo ci-dessous). Comme pour contourner une avancée de hautes terres ? Une esplanade de villa gallo-romaine par exemple. Etonnant, non ? Un cimetière à incinérations Au
même moment, loin au nord de Morterolles, les engins de
terrassement de la nouvelle Nationale 20, mirent au jour des urnes funéraires enterrées contenant
les restes de gallo-romains incinérés.
Les cimetières antiques sont très prisés en archéologie de terrain : c'est pourquoi finalement, on connaît mieux les gaulois morts que vivants.L'enquête archéologique ne permis pas de savoir si le cimetière se rattachait à la présence de la grande voie de circulation que nous venons d'évoquer ci-dessus mais dont personne au demeurant ne pouvait soupçonner l'existence . En effet, il est fréquent de découvrir des dépôts d'incinération sur les voies romaines car on mourait déjà beaucoup sur les routes à cette époque. On pensa par contre que le champ d'incinérations pouvait se rattacher à une hypothétique villa ou ferme du voisinage. Quoi qu'il en soit et à juste titre bien sûr, le cimetière fut minutieusement fouillé. |
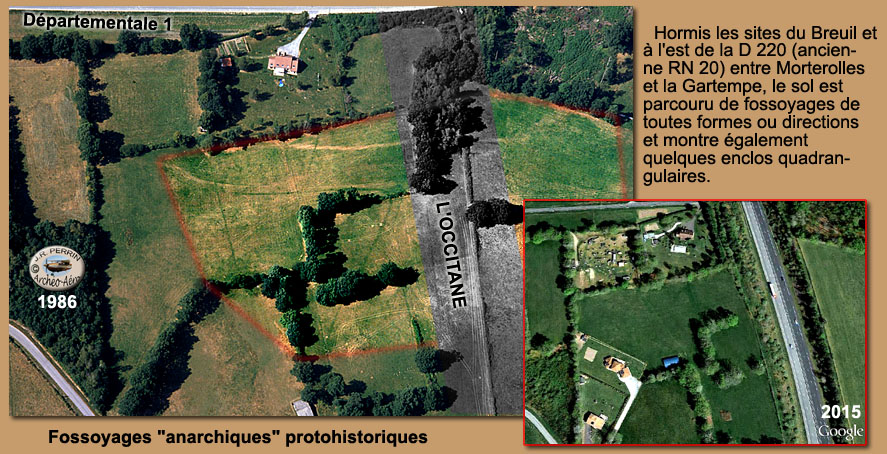
Une voie est-ouest de très ancienne origine
|
Sur le cliché ci-dessous qui essaie de rassembler l'essentiel des
renseignements collectés sur le site, on remarque sur le sommet de
l'interfluve, à deux pas du carrefour actuel de la Croix-du-Breuil et de ma voie
nord-sud retrouvée, qu'une autre voie, d'apparence
moins importante existe. Elle est orientée transversalement d'est en ouest et elle est connue depuis longtemps.
Les archéologues s'imaginent qu'elle est cachée sous la Départementale 1 mais cela ne fait pas problème : routes, chemins modernes et lisières de parcelles se sont souvent installé sur ou à proximité des grandes lignes de parcours. |
 |
On peut faire remonter son origine aux temps de l'indépendance gauloise :
une ancienne piste près de laquelle nous avons trouvé un sanctuaire typique, un vierekschanze. C'est un peu maigre mais "ça ne mange pas de pain" !
Au vu des traces que nous avons retrouvées il n'est pas hasardeux de penser que cet itinéraire fut repris à son compte par l'occupant romain qui lui appliqua dès lors un ravaudage apparemment léger, mais ne dérogeant pas fondamentalement aux techniques habituelles du Génie des Légions. Et ce cheminement serait ainsi
parvenu jusqu'à nous sous la forme
moderne des routes
départementales D 711 et D 1, qui en ont
rectifié le parcours .
|
|
Au demeurant
ce vénérable axe de circulation, transitant sur le
faîte de l'interfluve entre Gartempe et Semme par Châteauponsac, était
connu (en fait supputé sous les routes modernes), par l'érudition limousine.
|
|
Ainsi, à 2,500 kilomètres à l'ouest de la Croix-du-Breuil, on connaît un dépôt d'incinérations
en bordure nord d'un chemin qui a recouvert l'itinéraire
antique.
Au sud et à peu de distance du village de la Bussière-Etable on a découvert en 1946, une tombe où un riche et important personnage avait été enterré avec ses chars d'apparat, ses outils et ses ustensiles familiers (R. Beaubérot). Tout près, une villa fut découverte et fouillée dans les années 1960. Hors des sentiers battus
Et repartant à rebours, on peut même reconnaître,
émanant de la cote 294 et
passant au nord de la Bussière-Etable avant de se perdre
vers Le-Bois-du-Mont, le raccourci qui permettait sitôt
passé la Gartempe quelque part au sud de Bessines, de se
raccorder à
cet itinéraire de l'ouest en s'évitant la peine de monter au carrefour de La-Croix-du-Breuil.
|
 |
| Ce chemin, à peine carrossable
actuellement, montre sur nos photos agrandies qu'il est effectivement étroitement doublé au nord puis au sud, par
des fossés anciens. Ce genre de raccourci est un aménagement classique des carrefours romains. |
Aperçu sur le vieil itinéraire
|
Continuant vers l'ouest et à partir de Châteauponsac, ainsi que
le montre notre image, nous avons repéré sur ce vieil itinéraire, une
station à dévotions près du village du Verger.
|
 |
Nous trouverons une vue panoramique de ce site sur une prochaine page traitant des voies antiques au nord de Rancon, vieille bourgade gallo-romaine. Analyse sucinte du site ci-dessous. |
|
Au nord du site, un sanctuaire gaulois de sommet (vierekschanze) * domine la voie qui apparaît ici dédoublée (flêches rouges).
En dessous et au centre de l'image, sans doute plus tardifs, figurent un petit autel ou un laraire et une construction plus vaste, également carrée, des structures auprès desquelles un jour, fut sans doute dédié aux dieux romains le culte rendu auparavant aux dieux gaulois (zone ovalaire jaune). A cette époque (heureuse ?), on trouvait facilement des parentés célestes pour établir une coexistence pacifique entre des dieux de différentes origines. Mais les dévotions ont dû s'arrêter là car, à ma connaissance, aucune tradition chrétienne, pas même une "Croix de quelque chose" ne se rattache à cet endroit. |
Deux voies antiques parallèles
| Les Rieux A peine 1 km après les sanctuaires, notre itinéraire poursuit vers l'ouest ses deux tracés différents, grossièrement parallèles. Aucun indice ne permet de les hiérarchiser et on ignorera sans doute longtemps à quelle époque et pourquoi il devint un jour nécessaire de tracer une seconde route. La route moderne ( D1 ) représente le troisième et sans doute le dernier avatar de cet itinéraire. Continuant vers l'ouest, l'axe fossile le plus sud pousse |
 |
|
un diverticule qui traversera les terres des Bosnages avant de revenir se fondre à la voie principale à Maison-Neuve. Nous
reparlerons de ces sites et des voies de cette zone d'échanges au chapitre des voies autour de Rancon.
N B: Sur cette dernière photo on remarque partant vers le sud, une voie fossile (protohistorique ? antique ?) créée par l'usage et qui file vers la Gartempe et le hameau d'Auzillat en suivant l'arête d'une petite dorsale topographique (à gauche de la longue flèche rouge). |
Notre terminus de la voie transverse de la Croix-du-Breuil
|
Ces 25 kilomètres d'histoire nous ont amené a passer
près de Rancon. On présume que son nom antique
était "Roncomagus" et que l'on désignait les habitants de la contrée sous le nom d' Andecamulenses.
Nous y reviendrons longuement.Nous avons eu la chance de retrouver leurs traces. Celles qu'ils ont laissé sur le plateau ou à mi-pente avant que naisse par la volonté du romain, au-dessus de la Gartempe , un petit vicus (bourg) sur une bifurcation de routes. D'autres observations aériennes et de longs parcours au sol nous ont permis d'approcher la structure antique de ce vicus routier et de débroussailler le lacis routier généré - sur le dos de l'interfluve entre Gartempe et Semme- par cette bifurcation largement ouverte vers le nord et recoupée par la voie qui vient de nous occuper, venant de la Croix-du-Breuil.
Pour en finir avec une voie sur laquelle nous ne communiquerons
plus - hors les
bretelles de liaison liées aux carrefours
évoqués ci-contre - voici une longue perspective photographique vers
l'est sur ce très vieil itinéraire à partir du passage d'eau antique du Bouchaud, commune de Droux.
N B : Ces
itinéraires antiques usés par le passage durant de
nombreux siècles, présentent souvent des anomalies de
tracés, des raccourcis téméraires, des carrefours
avec des petites voies parfois impraticables, des diverticules
avortés : quelque chose comme une voie transverse venant d'un gué sur la Semme, en aval du Moulin du Pont. Elle attaque la montée du
|
 |
|
Tupet par un court passage à 40% de pente (étoile rouge, point noir)
: 40% de pente , ce n'est plus de la marche, c'est de l'escalade !
Et pourtant elle semble bien se diriger vers Puy-Martin par l'ouest des Vareilles. Or ce passage qui tranche l'interfluve au niveau des Vareilles est revendiqué depuis 260 ans par un archéologue qui en a fait le passage d'une voie antique qui aurait relié Argenton-sur-Creuse à Bordeaux (par Confolens et Saintes) : à qui se fier ! |
|
Nous
évoquons un possible sanctuaire sur la hauteur du Tupet : les
archives de l'IGN consultées montrent en 1989, une trace qui
irait dans le sens de notre photo.
Depuis lors la trace a disparu . . . dans une excavation. On remarquait sur une autre archive une trace linéaire diffuse qui reliait ce monument, à la voie "pentue" lors de sa sortie sur le plateau. Tout cela est peu convaincant. En amont du Bouchaud, un accés aménagé, visible sur notre cliché (marques jaunes) et tout à fait pratique, avait été prévu pour accéder à la terrasse alluviale de rive droite. Pour toutes sortes de bonnes raisons une sortie en rive gauche n'a jamais été réalisée à cet endroit.
Les photos de l'IGN permettent d'envisager la suite de l'itinéraire passant
au nord de Blanzac.
|
 |
 |
 |
 |