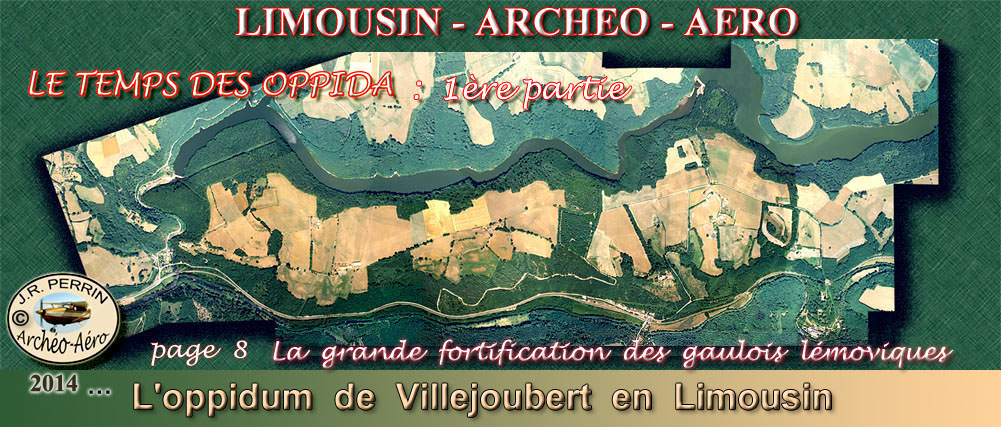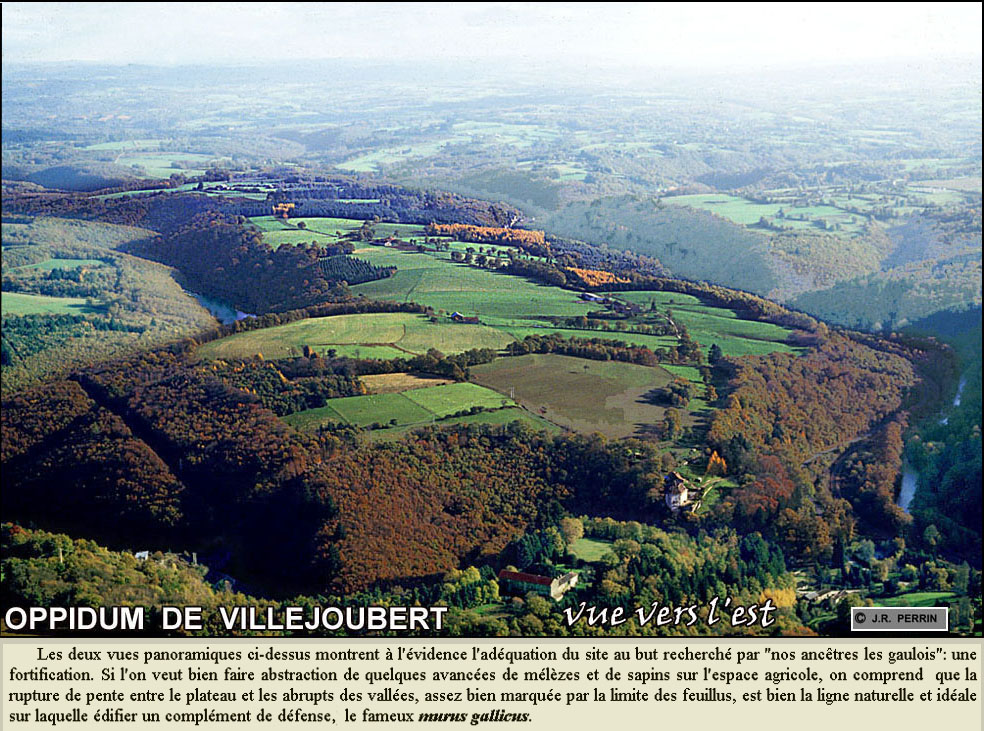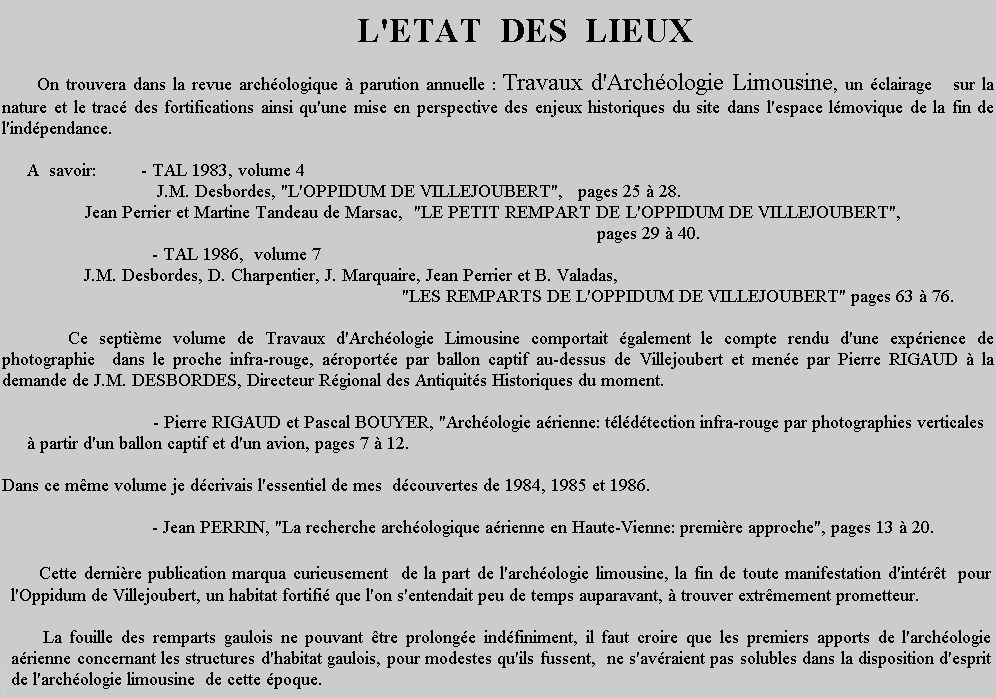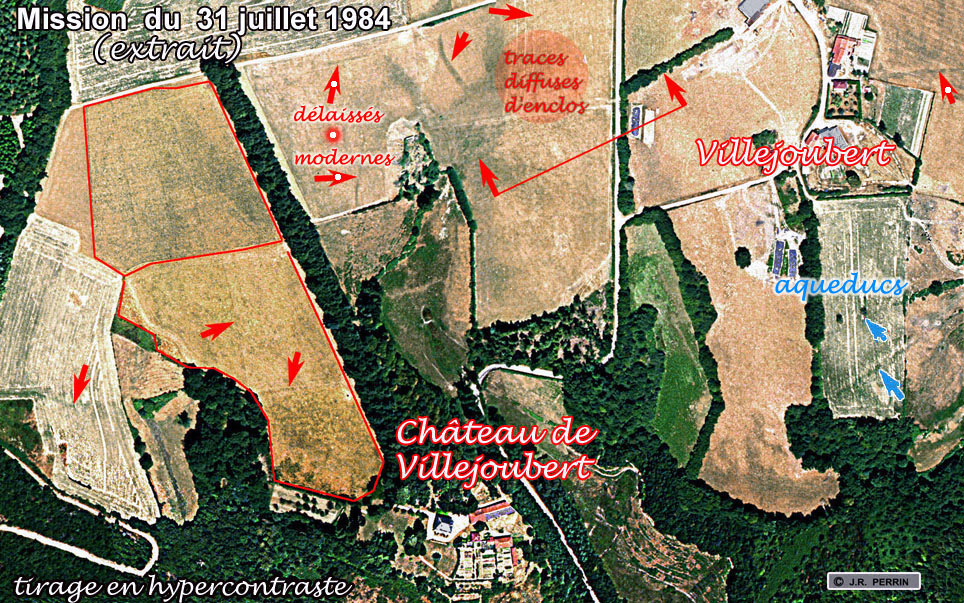Routes
modernes . . .
Au centre du cliché, à droite du mur de
barrage de
l'oppidum, la route Départementale 115 actuelle de Bujaleuf
à St Léonard de Noblat barre le
cliché. On
remarque au centre, immédiatement à droite du mur
de
barrage, en léger décalage de la route, la trace
sombre
et bien calibrée d'un délaissé
ancien.
Les
deux tracés utilisent la
même brèche percée au travers du murus
gallicus.
Il s'agit là d'itinéraires modernes qui ont
nécessité une
démolition ponctuelle, directe et sans précaution
spéciale d'un mur de défense qui n'était
plus perçu comme tel depuis des temps immémoriaux. Selon nous, aucun de ces
itinéraires, aussi bien l'ancien que l'actuel, n'ont
de chance
d'être d'origine protohistorique ou antique .
De nouveaux travaux
d'élargissement du passage sont connus au
siècle dernier en ce qu'ils ont attiré l'attention de
notables avertis qui ont découvert à cette occasion, des
"pointes de
flèches" dans les déblais.
Il s'agissait en fait des longs clous subsistant des
entrecroisements de troncs d'arbres qui armaient la terre des
fortifications gauloises .
Et de surcroît, plus loin, vers le milieu de l'oppidum, le
même itinéraire
de crête actuel va à nouveau perforer un
nouveau mur de barrage gaulois
découvert en sous-bois et désigné
sous le nom de "petit-rempart" par les
archéologues qui ont
relevé son emplacement et fouillé sa structure.
Mais l'étude du monument n'a donné lieu à aucune réflexion quant à sa place dans le système
défensif de l'oppidum.
Nous aurons l'occasion d'y revenir.
et cheminements gaulois
ou antiques
A l'extrémité orientale de l'oppidum, perpendiculairement au
délaissé de l'ancienne D 115 et à quelques
mètres seulement en contrebas du mur de barrage, on note une
zone
humide. Des
chenaux
- nous le vérifierons plus loin - émanent de la ferme récemment
disparue des Sagnettes. Ces très anciens fossés sont actuellement
réalimentés en eau par le réseau fossile de l'ancienne D 115 depuis
longtemps délaissée. Ces fossés de l'ancienne route
collectent l'eau qui
vient par le jeu de la pente, envahir les terrassements
gaulois et trahir ainsi leur existence :
voilà un
détail
qui s'avèrera d'une grande importance
archéologique pour
l'interprétation des indices que nous relèverons
lors de
prochains vols.
D'autant que si vous étiez passé
sur la
route à la fin des années 1980, vous n'auriez pas
manqué de
remarquer un ancien abreuvoir ou lavoir de racines
fourragères
qui fut un jour creusé sur cette trace, au-delà de la
route, par l'exploitant agricole pour profiter de cet apport d'eau pour le moins sporadique.
Toujours sur notre cliché ci-dessus, au
centre droit et
en haut, une large trace érodée prolonge une haie
courbe
et va se confondre avec la lisière d'un bois. Elle cache un ancien chemin joignant deux
gués (un sur chaque
rivière).
Son environnement immédiat, nous y reviendrons, comprendra un
enclos rectangulaire pratiquement accolé.
Proche du lieu-dit actuel "la Barrière", on remarque des zones
d'habitat qui prendront corps sur les photos d'une prochaine page,
des enclos avec "galerie de façade" en vis à vis, de
part et d'autre d'une petite dépression.
Ce cheminement est établi
hors fortification au fond
d'une légère ensellure, sur la partie la plus
étroite et la moins élevée de
l'oppidum : c'est une
limite de communes calquée sur une limite de paroisse. Son
origine se perd sans doute dans la nuit des temps mais on peut
être assuré que ce passage protohistorique
était encore
utilisé dans l'antiquité tardive, au Moyen-Age et plus tard
encore.
Enfin,
limitée à l'est par le mur de barrage de
l'oppidum, qui passe près de l'ancienne
ferme des Sagnettes, une parcelle ne demande qu'à
être
qualifiée de paracirculaire si on veut bien nous accorder
qu'elle ait pu, dans les temps très anciens qui nous
occupent, s'étendre au nord et
au-delà de la route
départementale actuelle; elle est signalée au sol
par une
pancarte: "Le
Camp de César". Elle n'a pas particulièrement
attiré semble-t-il l'attention
des archéologues de terrain qui n'y ont observé
aucun mobilier ancien semble-t-il. Pourtant son apparence incite
à penser à un
fortin, un bastion, un point de défense
appuyé sur une
partie
de la fortification, la moins bien naturellement
défendue.
Un inventaire archéologique reste
peut-être à faire.
Pour ne pas alourdir exagérément le
commentaire et anticiper sur la suite de la description, un
certain nombre d'indices sont simplement signalés par des
flêches: cheminements, fossés, zones
usées,
érodées ou au contraire comblées
naturellement,
remblayées. |