
|
Jean Régis PERRIN
L'Oppidum de Villejoubert sous photographie infrarouge (II) Une approche alternative : le bilan d'une technique, après les premiers apports de la photographie aérienne classique. |


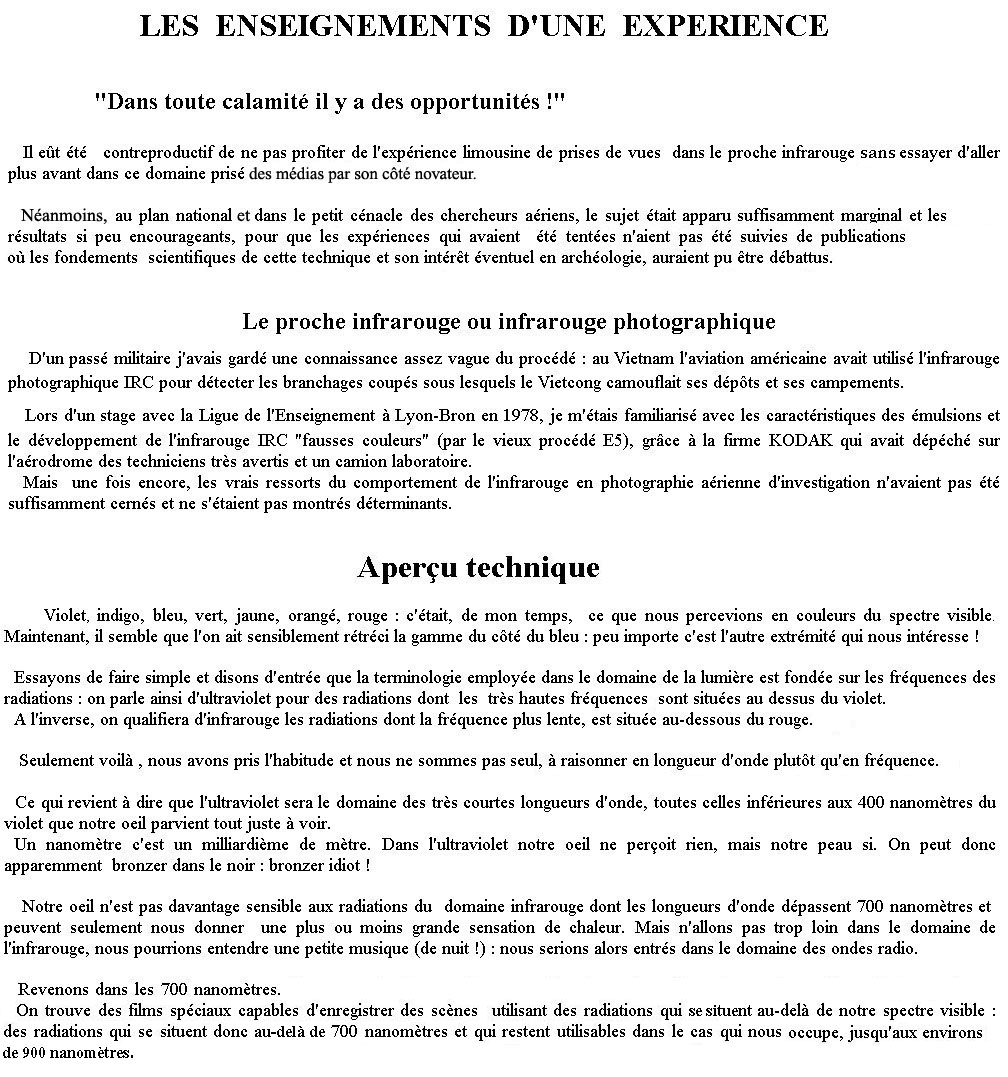

La prise de vue Dans cette manipulation, il est évident que je me situe dans le cas général de l'époque, d'un appareil du type "réflex" prenant des vues sur une pellicule argentique spéciale. En noir-et-blanc et eu égard au filtre "masque de soudeur", on ne peut donc pas cadrer les prises de vues car on ne voit rien dans le viseur et du même coup, l'appareil photographique ne peut mesurer ni la distance, ni évaluer la vitesse pas plus que l'ouverture. L'appareil se règle donc par tâtonnement et se cale par l'expérience : une bonne approche consistait à enlever temporairement le filtre et à récupérer le paramètre d'ouverture en affichant une sensibilité de 100 iso pour le 500ème de seconde, une vitesse suffisante pour figer le terrain malgré la vitesse de l'avion. Puis on décale légèrement la mise au point (repère rouge sur le barillet de l'objectif), on remet le filtre et on "shoote" au jugé. Ceci
est valable pour le film KODAK infrarouge noir et blanc (High Speed
Infrared 2481) que l'on peut développer soi-même.
Il existe dans ce même domaine, nous l'avons évoqué, une autre catégorie de film, inversible dite infrarouge fausses couleurs (IRC), au rendu colorimétrique décalé, sensible dans un spectre un peu rétréci et donc moins performant à dire d'expert. Les trois photos qui figurent au centre du bandeau de présentation de cette page montrent : - en vertical, le petit oppidum de la Motte-Chalard près de Saint-Gence (Camp de César). Photo infrarouge N et B avec filtre Kodak 87 C, - environs de Bourgoin-Jallieu (Isére) stage Lyon-Bron 1978, en IRC avec filtre rouge, - l'allée du Château - "les hortus" - à Villejoubert en IRC, exceptionnellement filtré par Kodak 87C. Très loin de là, en progressant vers les ondes radio, il existe des créneaux, des fenêtres du ciel (car on ne peut recueillir que ce que le ciel nous envoie), dont le plus performant se situe autour d'une longueur d'onde de 11 000 nanomètres . Mais nous sommes là dans l'infrarouge lointain qui ne peut être enregistré que par des radiomètres (scanners) ou des caméras très spéciales. Les images sont visibles sur écran électronique (video gratias), dessinées par les variations de température du sujet. Ces appareils présentent une sensibilité de l'ordre de quelques dixièmes de degré centigrade. S'agissant des caméras et avant enregistrement, les radiations doivent traverser une lame d'azote liquide. L'usage aéroporté des ces appareils est soumis à autorisation mais un professionnel intéressé nous décida à tenter l'expérience : le réservoir d'azote n'allait-il pas se vider en position verticale ? Je choisis Villejoubert évidemment : l'azote liquide resta en place mais au-dessus de Feytiat le magnétoscope enregistreur tomba en panne. Pour des raisons pécuniaires, il n'y eut pas de seconde tentative. Dommage ! |
|
Notre expérience
Suite à l'expérience menée
par Pierre RIGAUD
en novembre 1985, il nous était apparu utile de
procéder
à
plusieurs reprises dans les années qui suivirent, à des prises
de vues aériennes infrarouges sur
l'oppidum. Avec
ce procédé, nous
n'avons jamais repéré que ce
que nous
connaissions déjà par l'observation et la photo
classique et au
mieux, ce que nous allions connaître dans les mois suivants.
Cela nous permis également de déjouer la prédiction des augures pseudo-scientifiques en la matière : même pas floues, les photos ! Qui l'eût cru ! Un seul cliché résumera notre propos: observons-le ! |
 |
Nous
constatons l'action énorme de la radiation infrarouge envoyée par le
soleil et réfléchie par les feuilles : c'est "l'effet de neige".
En effet et c'est là un des enseignements de l'expérience menée par Pierre RIGAUD: lorsque les plantes peuvent s'assurer une alimentation hydrique normale, les cellules végétales sont en état de turgescence et leurs parois, tendues sous l'afflux de sève, constituent un réflecteur très performant pour les radiations infrarouges. Et nous étions là sur une fin de printemps convenablement arrosé. Si par contre, une période de sécheresse survient, très vite au bout de quelques semaines l'apport hydrique diminue , les cellules perdent de leur turgescence et la réflexion de l'infrarouge diminue : " la neige devient sale". Jusqu'au moment d'un flétrissement éventuel où toute réflexion cesserait. Du gris on passerait au noir. Le même phénomène survient brutalement sur les feuilles d'un rameau lorsqu'il est coupé. |
|
On constate sur notre cliché que l'herbe
réfléchit
également bien l'infra-rouge ce qui est normal. Mais la
teinte grise
est due au fait que le sol
qui absorbe l'infrarouge,
transparaît plus ou moins entre les touffes. Les très courtes ombres portées participent également au phénomène. Observons également que l'eau de la Maulde ne réfléchit pas du tout l'infrarouge. Au total aucun signe d'anomalie flagrante n'apparaît sur le cliché : sauf peut-être et pour les bons observateurs, vers le coin inférieur gauche du cliché. Là précisément, nous sommes sur un terrain éclairé par nos photos de 1984 : sur la photo infrarouge, sortant de la pointe du bois au nord et visible d'abord par l'ombre portée d'un fin linéament d'herbe plus haute, le murus gallicus de La Clautre. Ne pas confondre avec le liseré sensiblement plus prononcé, qui marque une limite de propriété. |
 |
|
Il se prolonge vers le sud en pied de talus. Les éboulis n'ont pas inhibé la pousse de
l'herbe, ils l'auraient même
favorisée en cette période de
giboulées
abondantes.
Puis le murus s'infléchit vers l'est, délimitant ainsi un léger tertre jusqu'à la ligne d'arbres qui nous cache un vieux chemin qui monte vers la ferme. |

| Sur
ce tertre
on remarque 2 bandes,
qui apparaissent en
granité
noir-profond, sensiblement parallèles entre elles et à la tombée du murus |
|
Sur ce dessin tiré au cordeau,
on envisage,
traversant la couche herbacée, l'apparition de deux bandes
de
sol nu et plus probablement encore de
deux cordons de grosses
pierres ou de cailloux comme deux
murs parallèles
dont le couronnement affleurerait au milieu du massif. Notons que l'image en couleurs normales (Fujichrome) ne montre rien du phénomène.
Quelques semaines plus tard le même
indice apparaissait dans le visible (grosses
flèches rouges).
Mais, dans ce cas de figure, il était beaucoup plus
difficile
d'avancer sérieusement une cause au
phénomène observé, sauf
à aller l'observer sur place ce que nous n'avons pas fait.
Ce serait peut-être le moment de mettre en avant une notion équivoque employée par César dans la "Guerre des Gaules" et qui intrigue semble-t-il certains archéologues : le "murus duplex", le mur double, un renforcement dans l'âme de la fortification constitué par deux murs verticaux venant faire redan sur le couronnement de l'ouvrage. De bello gallico, 2, 29. N B : Figurent encore quelques indices extraordinairement ténus qui nous entraîneraient dans de trop longues spéculations. |
L'EXPERIENCE DE PIERRE RIGAUD
L'expérience menée par Pierre RIGAUD,
malgré son unique
photo rendue publique et l'usage minimaliste qui en fut fait comme on
le verra,
était plus instructive que la nôtre
dont nous
venons de faire état.
Nous le retrouverons quelques
mois plus tard et avec plus de
précision, dans le spectre visible.Les aléas climatiques contrastés précédant cette période de la mi-novembre 1985, animent la photo infrarouge du physicien en générant des zones fortement tranchées : le sol avait subi une longue période de sécheresse et on sortait de quelques jours de pluies abondantes. Un timide état végétatif se maintenait "en effet de neige" partout où l'aridité ambiante et les aleas climatiques n'avaient pas été fatals et irréversibles pour l'herbe et les restes de culture. On peut observer en particulier un regain d'après sécheresse sur les têtes de source et au long des anciennes rigoles d'irrigation. Et c'est par ce même phénomène qu'apparaissait sur la photo, un enclos gaulois dessiné par ses fossés comblés d'éléments meubles qui avaient sans doute retenu quelque humidité durant la longue période aride et évité à l'herbe sujacente et éventuellement à la culture de betterave que portait la parcelle, de péricliter. Un "mince filet blanc d'herbe verte" dessinait maintenant en filigrane, un habitat gaulois bipartite avec son entrée en couloir. |
| Le " syndrome du Beuvray " |
| Il faut
préciser avant tout autre commentaire, qu'en scientifique avisé et
intègre, Pierre RIGAUD avait monté un dispositif qui permettait de
prendre, en même temps que la photo infrarouge, une photo en
noir-et-blanc classique à titre d'épreuve témoin. NB : L'aspect légèrement guilloché de la photo panchromatique est probablement dû à une réflexion parasite sur le fond-presseur de l'appareil photographique. |
 |
Mais voilà qu'au sujet précisément de l' image infrarouge, l'autorité archéologique régionale présente sur les lieux, concluait, au rebours de l'enseignement du scientifique voire des rares témoignages de la littérature archéologique venue d'autres régions, à des solins de murs qui auraient dessiné l'enclos gaulois (5). C'était sans doute là l'effet d'une analyse précipitée et orientée par des considérations extérieures au sujet. Mais en fait l'image infrarouge de Pierre RIGAUD, portait d'autres traces que celles de ce pauvre enclos aperçu en filigrane. Et on aurait pu penser qu'elles auraient été reconnues dans le temps de réflexion qui s'était écoulé entre la photographie infrarouge du terrain et la publication des résultats. |
Des indices évidents car déjà entrevus
|
Sur le cliché ci-dessus, en infrarouge N et B :
- dans la parcelle du haut - en angle - la plage noire d'un labour récent (1), encore humide, - puis, en dessous, deux traits noirs (2) qui barrent la parcelle triangulaire d'une prairie. Deux traits noirs sensiblement parallèles : c'étaient, et on aurait pu s'en douter en comparant ce cliché avec nos photos de 1984 . . . les lignes (haute et basse) d'éboulis du murus gallicus secondaire de La Clautre, dont la présence affleurante et asséchante n'avait pas permis à l'herbe de passer le cap des mois de sécheresse. Il était ainsi constaté l'effet drainant du substrat pierreux entraînant le flétrissement de la strate herbacée : teinte noire par absence de réflexion de l'infrarouge sur l'herbe temporairement desséchée et qui ne ferait son regain qu'au printemps suivant. Et on notera en parfaite logique, que par référence à nos photos de 1984, le même artefact apparaît en clair sur nos photos en couleurs conventionnelles. Et ce n'est qu'à l'automne suivant (1986) qu'une seconde identification diffuse dans le spectre visible est venu confirmer nos vues. En effet, sur un labour presque entièrement |
 |
| ressuyé, nous avons alors observé et saisi en photographie conventionnelle - une surcharge d'humus de
couleur sombre
(cliché ci-contre). Nous avons alors compris l'origine de cette zone d'absorption relevée sur la photo infrarouge de Pierre RIGAUD : un placage d'humus encore gorgé d'eau (4) et absorbant l'infrarouge en tant que masque d'éboulement et d'effondrement d'une probable et très ancienne construction en pisé (argile, paille et bois). Située à peu de distance du mur et reliée à lui par une trace biaise de même apparence (3) : l'image d'une porte possible taillée dans le murus gallicus (voir page suivante). |
|
Mais, c'était là
bien sûr, une
analyse comparative osée dont aucune
publication
ne nous a jusqu'à ce jour, donné la clé.
Mais les constats que nous avions photographiquement établis l'année précédente en 1984, étaient pourtant là qui auraient dû permettre de faire déjà cette interprétation.
Il est regrettable que
30 ans plus tard , les apports de cette
technique photographique particulière aussi bien d'ailleurs que
celles classiques, de prise de vue oblique et verticale, soient
restées marginales dans les démarches de
l'archéologie conventionnelle qui
n'a
guère intégré la
recherche aérienne autrement qu'à titre de
curiosité : la corporation reste certes friande de clichés
aériens mais ne se montre guère à même d'en saisir les
nombreuses nuances au-delà de pauvres anecdotes.
Ce regret durable nous suivra jusqu'à Chassenon-Cassinomagus, la gallo-romaine. Voir la dernière page de notre second site
(archeologieaerienne-marchelimousin.fr).
|
|
Au bilan de l'infrarouge en archéologie
Une seule
photo "réussie" donc et sur laquelle on n'a pu voir
que
la simple évocation d'un enclos rectangulaire, original dans sa
complexité, encore jamais observé . . . et toujours en
attente d'interprétation.
Une seule photo "réussie" sur 150 . . . On peut s'interroger sur les éventuelles révélations qu'auraient pu apporter - et seraient encore à même de le faire en des mains expertes - les 149 autres photos infrarouges toujours inconnues et dont on n'a plus jamais entendu parler. Au bilan, "l'expérience unique réussie en Limousin" du journal, laissait l'emploi de l'infrarouge photographique en archéologie aérienne, au rang d'une petite technique aux résultats fantasques, irréguliers et à ce titre, peu convaincants. Une
expérience unique en effet,
pour un résultat précaire, interprété à minima : une image orpheline pour une quête de notoriété hors de prix ! |
 |
 |
 |
 |